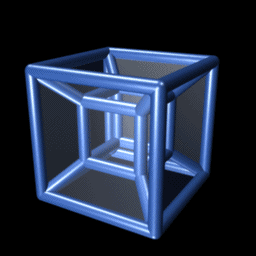Suite
Le triangle du désir
De sentir le plein, tellement
Il y a du vide"
Eugène Guillevic (Éditions Gallimard)
Fixer son attention admirative sur un modèle, c'est déjà lui reconnaître ou lui accorder un prestige que l'on ne possède pas, ce qui revient à constater sa propre insuffisance d'être. Ce n'est bien évidemment pas une position des plus confortables mais l'homme qui admire, et qui par delà envie l'Autre, est d'abord quelqu'un qui se méprise profondément. Mais si le modèle est si parfait, c'est qu'il doit détenir quelque chose dont le sujet est pour l'instant démuni : objet matériel, attitude, statut, etc. Les variations sont infinies pour un résultat toujours identique : ce qui le différencie de l'Autre justifie, aux yeux du désir du sujet, la réussite et le prestige qu'il lui accorde.
Le désir qu'a le sujet pour l'objet n'est rien d'autre que le désir qu'il a du prestige qu'il prête à celui qui possède l'objet (ou qui s'apprête à désirer en même temps que lui l'objet). C'est ainsi que s'institue la médiation du modèle et une première transfiguration de l'objet. Par exemple, une voiture est plus que cette carcasse d'acier permettant de se déplacer d'un endroit à un autre, sinon n'importe quel modèle ferait l'affaire ; elle est l'instrument qui permettrait au sujet d'être, à l'instar de son modèle, un "tombeur", un cadre supérieur, un chef de bande, etc. Ce que vise le désir n'est bien sûr pas la possession de l'objet-voiture mais ce qu'il croit que cette possession lui donnera, comme à l'Autre, en termes de conquêtes féminines ou d'identification sociale.
Comme le note René Girard, le sujet méconnaîtra toujours cette antériorité du modèle, car ce serait du même coup dévoiler son insuffisance, son infériorité, le fait que son désir est, non pas spontané mais imité. Il aura beau jeu ensuite de dénoncer la présence de l'Autre, médiateur de son désir, comme relevant de la seule envie de ce dernier.

Le modèle n'est pas plus épargné que le sujet. Lui aussi cherche à fixer son désir et il attend qu'on lui désigne quelque chose de désirable. C'est bien ce que fait le sujet de notre triangle qui, de ce point de vue, est bien lui aussi un Autre. Nous savons déjà que ce n'est pas l'objet que va voir à présent le modèle, mais un objet transfiguré par le désir du sujet, qui lui donne une "valeur" tout à fait inattendue.
Le modèle n'a pas un rôle passif dans ce triangle. Il ne se contente pas d'attendre une manifestation du sujet, il fait au contraire tout pour faire naître celle-ci. Comme un objet que personne ne lui disputerait n'aurait aucun intérêt, aucune valeur capable de fixer son propre désir, tout le pousse à exposer au regard des autres sa bonne fortune - qui ne devient avantage en terme d'être que s'il est reconnu comme tel par ces mêmes autres. Le désir du modèle a besoin de sentir d'autres désirs pour pouvoir être conforté. Il tend donc toujours à susciter lui-même la concurrence, c'est-à-dire à provoquer l'émergence d'un rival qu'il lui appartiendra ensuite de supplanter.
L'amoureuse vantant les qualités de son partenaire auprès de ses amies cherche autant à affirmer, vanité ou orgueil, la supériorité de son bonheur qu'à confirmer son propre désir. La meilleure réponse serait que ses amies, envieuses de ce bonheur, se mettent toutes à désirer le-dit partenaire, à l'exclusion de tout autre prétendant. Ceci ne ferait que confirmer l'amoureuse dans sa certitude chancelante qu'elle tient le bon. L'objet n'est déjà plus le petit copain - sans doute très quelconque - de Mlle X., mais il devient peu à peu le garçon quasiment unique que toutes se disputent, c'est-à-dire une illusion née des désirs concurrents. A l'extérieur de cette rivalité, c'est-à-dire à un endroit d'observation non gagné par cette illusion, tous se poseront la question : "Mais qu'est-ce qu'elles lui trouvent ?".
La circularité infernale du désir mimétique est maintenant en place. Aucune recrudescence du désir du modèle pour l'objet n'échappera au sujet, qui y verra la confirmation de son importance et qui redoublera d'efforts pour le posséder. Chacun donc, sujet ou modèle, a contribué à l'émergence de l'autre en tant que rival.
Médiation interne, externe
les dieux que nous avons en nous."
René Char - La Parole en archipel (Gallimard - 1962)
" Le désir selon l'Autre est toujours le désir d'être un Autre. Il n'y a qu'un seul désir métaphysique mais les désirs particuliers qui concrétisent ce désir primordial varient à l'infini." (MRVR p.101)
C'est bien sûr ce que fait Don Quichotte avec Amadis de Gaule : pour
devenir un parfait chevalier, il suffit d'imiter les actes d'un
chevalier parfait. C'est aussi ce que vont faire, par exemple, tous
les petits enfants dans leur apprentissage des conduites sociales, de
la propreté ou du langage. En imitant les adultes, parents ou
enseignants, et ce avec une précision redoutable, ils font comme
les grands, mieux, ils deviennent grands.
Dans ces deux cas, il n'y a pas de réelle interférence entre les
sphères d'intentions et d'actions du sujet et du modèle ; René Girard
parlera alors de médiation externe. Quichotte peut bien imiter en
tout point ce qu'il pense être le comportement de son héros, ce qui
sépare l'un de l'autre reste invariant malgré les exploits du
chevalier. Le modèle Amadis ne désigne rien de particulier et les
échecs du Quichotte n'emportent aucune conséquence puisqu'il peut
aisément passer à autre chose. De même les jeunes enfants imitent au
plus près leurs éducateurs, on les y encourage même, mais à
l'intérieur d'un cadre pédagogique qui maintient une certaine
distance entre sujet et modèle, interdisant la confusion. Si beaucoup
de petites filles veulent devenir maîtresses d'école, c'est
plus tard, et tout est dans ce "plus tard".

L'éloignement sujet - modèle qui caractérise la médiation externe n'est pas une simple question de distance physique ou temporelle, mais tient également à la nature des différences séparant, à l'origine, l'un et l'autre.
"Bien que l'éloignement géographique puisse en constituer un facteur, la distance entre le médiateur et le sujet est d'abord spirituelle. D.Q. et Sancho sont toujours physiquement proches mais la distance sociale et intellectuelle qui les sépare demeure infranchissable." (MRVR, page 22).
Cependant, sauf à évoluer dans le vide - qui est une des illusions
romantiques -, le désir va forcément entrer en contact avec d'autres
désirs. Il le fera d'autant plus facilement et rapidement que ceux-ci
sont proches, c'est-à-dire s'intéressent aux mêmes objets. Ainsi,
rien ne sépare M. de Rênal de Valenod, qui s'affrontent tous les deux
pour dominer la vie sociale de Verrières et qui sont donc très
attentifs à ce que qu'est et ce que fait l'Autre : Julien Sorel n'est
pas le précepteur possible chez l'un où l'autre, il est celui qui
permettra à son employeur d'obtenir un avantage dans cette lutte de
prestige.
Cette proximité des désirs et la rivalité qu'elle entraîne va
caractériser ce que Girard nommera dans un premier temps la médiation
interne et qui deviendra par la suite le désir mimétique.
Suite